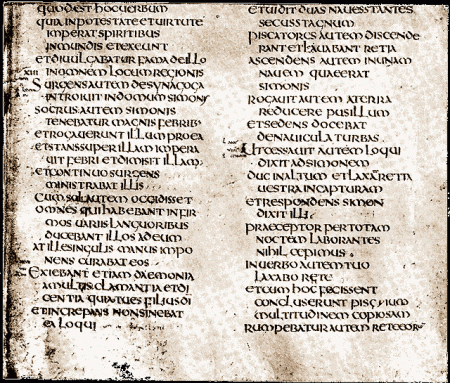Benoît XVI, encyclique Caritas in veritate :
48. Le thème du développement est aussi aujourd’hui fortement lié aux devoirs qu’engendre le rapport de l’homme avec l’environnement naturel. Celui-ci a été donné à tous par Dieu et son usage représente pour nous une responsabilité à l’égard des pauvres, des générations à venir et de l’humanité tout entière. Si la nature, et en premier lieu l’être humain, sont considérés comme le fruit du hasard ou du déterminisme de l’évolution, la conscience de la responsabilité s’atténue dans les esprits. Dans la nature, le croyant reconnaît le merveilleux résultat de l’intervention créatrice de Dieu, dont l’homme peut user pour satisfaire ses besoins légitimes – matériels et immatériels – dans le respect des équilibres propres à la réalité créée. Si cette vision se perd, l’homme finit soit par considérer la nature comme une réalité intouchable, soit, au contraire, par en abuser. Ces deux attitudes ne sont pas conformes à la vision chrétienne de la nature, fruit de la création de Dieu.
La nature est l’expression d’un dessein d’amour et de vérité. Elle nous précède et Dieu nous l’a donnée comme milieu de vie. Elle nous parle du Créateur (cf. Rm 1, 20) et de son amour pour l’humanité. Elle est destinée à être « récapitulée » dans le Christ à la fin des temps (cf. Ep 1, 9-10; Col 1, 19-20). Elle a donc elle aussi une « vocation » [115]. La nature est à notre disposition non pas comme « un tas de choses répandues au hasard » [116], mais au contraire comme un don du Créateur qui en a indiqué les lois intrinsèques afin que l’homme en tire les orientations nécessaires pour « la garder et la cultiver » (Gn 2, 15). Toutefois, il faut souligner que considérer la nature comme plus importante que la personne humaine elle-même est contraire au véritable développement. Cette position conduit à des attitudes néo-païennes ou liées à un nouveau panthéisme: le salut de l’homme ne peut pas dériver de la nature seule, comprise au sens purement naturaliste. Par ailleurs, la position inverse, qui vise à sa technicisation complète, est également à rejeter car le milieu naturel n’est pas seulement un matériau dont nous pouvons disposer à notre guise, mais c’est l’œuvre admirable du Créateur, portant en soi une « grammaire » qui indique une finalité et des critères pour qu’il soit utilisé avec sagesse et non pas exploité de manière arbitraire. Aujourd’hui, de nombreux obstacles au développement proviennent précisément de ces conceptions erronées. Réduire complètement la nature à un ensemble de données de fait finit par être source de violence dans les rapports avec l’environnement et finalement par motiver des actions irrespectueuses envers la nature même de l’homme. Étant constituée non seulement de matière mais aussi d’esprit et, en tant que telle, étant riche de significations et de buts transcendants à atteindre, celle-ci revêt un caractère normatif pour la culture. L’homme interprète et façonne le milieu naturel par la culture qui, à son tour, est orientée par la liberté responsable, soucieuse des principes de la loi morale. Les projets en vue d’un développement humain intégral ne peuvent donc ignorer les générations à venir, mais ils doivent se fonder sur la solidarité et sur la justice intergénérationnelles, en tenant compte de multiples aspects: écologique, juridique, économique, politique, culturel [117].
49. Aujourd’hui, les questions liées à la protection et à la sauvegarde de l’environnement doivent prendre en juste considération les problématiques énergétiques. L’accaparement des ressources énergétiques non renouvelables par certains États, groupes de pouvoir ou entreprises, constitue, en effet, un grave obstacle au développement des pays pauvres. Ceux-ci n’ont pas les ressources économiques nécessaires pour accéder aux sources énergétiques non renouvelables existantes ni pour financer la recherche de nouvelles sources substitutives. L’accaparement des ressources naturelles qui, dans de nombreux cas, se trouvent précisément dans les pays pauvres, engendre l’exploitation et de fréquents conflits entre nations ou à l’intérieur de celles-ci. Ces conflits se déroulent souvent sur le territoire même de ces pays, entraînant de lourdes conséquences: morts, destructions et autres dommages. La communauté internationale a le devoir impératif de trouver les voies institutionnelles pour réglementer l’exploitation des ressources non renouvelables, en accord avec les pays pauvres, afin de planifier ensemble l’avenir.
Sur ce front aussi, apparaît l’urgente nécessité morale d’une solidarité renouvelée, spécialement dans les relations entre les pays en voie de développement et les pays hautement industrialisés [118]. Les sociétés technologiquement avancées peuvent et doivent diminuer leur propre consommation énergétique parce que d’une part, leurs activités manufacturières évoluent et parce que d’autre part, leurs citoyens sont plus sensibles au problème écologique. Ajoutons à cela qu’il est possible d’améliorer aujourd’hui la productivité énergétique et qu’il est possible, en même temps, de faire progresser la recherche d’énergies substitutives. Toutefois, une redistribution planétaire des ressources énergétiques est également nécessaire afin que les pays qui n’en ont pas puissent y accéder. Leur destin ne peut être abandonné aux mains du premier venu ou à la logique du plus fort. Ce sont des problèmes importants qui, pour être affrontés de façon efficace, demandent de la part de tous une prise de conscience responsable des conséquences qui retomberont sur les nouvelles générations, surtout sur les très nombreux jeunes présents au sein des peuples pauvres et qui « demandent leur part active dans la construction d’un monde meilleur » [119].
50. Cette responsabilité est globale, parce qu’elle ne concerne pas seulement l’énergie, mais toute la création, que nous ne devons pas transmettre aux nouvelles générations appauvrie de ses ressources. Il est juste que l’homme puisse exercer une maîtrise responsable sur la nature pour la protéger, la mettre en valeur et la cultiver selon des formes nouvelles et avec des technologies avancées, afin que la terre puisse accueillir dignement et nourrir la population qui l’habite. Il y a de la place pour tous sur la terre: la famille humaine tout entière doit y trouver les ressources nécessaires pour vivre correctement grâce à la nature elle-même, don de Dieu à ses enfants, et par l’effort de son travail et de sa créativité. Nous devons cependant avoir conscience du grave devoir que nous avons de laisser la terre aux nouvelles générations dans un état tel qu’elles puissent elles aussi l’habiter décemment et continuer à la cultiver. Cela implique de s’engager à prendre ensemble des décisions, « après avoir examiné de façon responsable la route à suivre, en vue de renforcer l’alliance entre l’être humain et l’environnement, qui doit être le reflet de l’amour créateur de Dieu, de qui nous venons et vers qui nous allons » [120]. Il est souhaitable que la communauté internationale et chaque gouvernement sachent contrecarrer efficacement les modalités d’exploitation de l’environnement qui s’avèrent néfastes. Il est par ailleurs impératif que les autorités compétentes entreprennent tous les efforts nécessaires afin que les coûts économiques et sociaux dérivant de l’usage des ressources naturelles communes soient établis de façon transparente et soient entièrement supportés par ceux qui en jouissent et non par les autres populations ou par les générations futures: la protection de l’environnement, des ressources et du climat demande que tous les responsables internationaux agissent ensemble et démontrent leur résolution à travailler honnêtement, dans le respect de la loi et de la solidarité à l’égard des régions les plus faibles de la planète [121]. L’une des plus importantes tâches de l’économie est précisément l’utilisation la plus efficace des ressources, et non leur abus, sans jamais oublier que la notion d’efficacité n’est pas axiologiquement neutre.
51. La façon dont l’homme traite l’environnement influence les modalités avec lesquelles il se traite lui-même et réciproquement. C’est pourquoi la société actuelle doit réellement reconsidérer son style de vie qui, en de nombreuses régions du monde, est porté à l’hédonisme et au consumérisme, demeurant indifférente aux dommages qui en découlent [122]. Un véritable changement de mentalité est nécessaire qui nous amène à adopter de nouveaux styles de vie « dans lesquels les éléments qui déterminent les choix de consommation, d’épargne et d’investissement soient la recherche du vrai, du beau et du bon, ainsi que la communion avec les autres hommes pour une croissance commune » [123]. Toute atteinte à la solidarité et à l’amitié civique provoque des dommages à l’environnement, de même que la détérioration de l’environnement, à son tour, provoque l’insatisfaction dans les relations sociales. À notre époque en particulier, la nature est tellement intégrée dans les dynamiques sociales et culturelles qu’elle ne constitue presque plus une donnée indépendante. La désertification et la baisse de la productivité de certaines régions agricoles sont aussi le fruit de l’appauvrissement et du retard des populations qui y habitent. En stimulant le développement économique et culturel de ces populations, on protège aussi la nature. En outre, combien de ressources naturelles sont dévastées par les guerres! La paix des peuples et entre les peuples permettrait aussi une meilleure sauvegarde de la nature. L’accaparement des ressources, spécialement de l’eau, peut provoquer de graves conflits parmi les populations concernées. Un accord pacifique sur l’utilisation des ressources peut préserver la nature et, en même temps, le bien-être des sociétés intéressées.
L’Église a une responsabilité envers la création et doit la faire valoir publiquement aussi. Ce faisant, elle doit préserver non seulement la terre, l’eau et l’air comme dons de la création appartenant à tous, elle doit surtout protéger l’homme de sa propre destruction. Une sorte d’écologie de l’homme, comprise de manière juste, est nécessaire. La dégradation de l’environnement est en effet étroitement liée à la culture qui façonne la communauté humaine: quand l’« écologie humaine » [124] est respectée dans la société, l’écologie proprement dite en tire aussi avantage. De même que les vertus humaines sont connexes, si bien que l’affaiblissement de l’une met en danger les autres, ainsi le système écologique s’appuie sur le respect d’un projet qui concerne aussi bien la saine coexistence dans la société que le bon rapport avec la nature.
Pour préserver la nature, il n’est pas suffisant d’intervenir au moyen d’incitations ou de mesures économiques dissuasives, une éducation appropriée n’y suffit pas non plus. Ce sont là des outils importants, mais le point déterminant est la tenue morale de la société dans son ensemble. Si le droit à la vie et à la mort naturelle n’est pas respecté, si la conception, la gestation et la naissance de l’homme sont rendues artificielles, si des embryons humains sont sacrifiés pour la recherche, la conscience commune finit par perdre le concept d’écologie humaine et, avec lui, celui d’écologie environnementale. Exiger des nouvelles générations le respect du milieu naturel devient une contradiction, quand l’éducation et les lois ne les aident pas à se respecter elles-mêmes. Le livre de la nature est unique et indivisible, qu’il s’agisse de l’environnement comme de la vie, de la sexualité, du mariage, de la famille, des relations sociales, en un mot du développement humain intégral. Les devoirs que nous avons vis-à-vis de l’environnement sont liés aux devoirs que nous avons envers la personne considérée en elle-même et dans sa relation avec les autres. On ne peut exiger les uns et piétiner les autres. C’est là une grave antinomie de la mentalité et de la praxis actuelle qui avilit la personne, bouleverse l’environnement et détériore la société.
52. La vérité et l’amour que celle-ci fait entrevoir ne peuvent être fabriqués. Ils peuvent seulement être accueillis. Leur source ultime n’est pas, ni ne peut être, l’homme, mais Dieu, c’est-à-dire Celui qui est Vérité et Amour. Ce principe est très important pour la société et pour le développement, car ni l’une ni l’autre ne peuvent être produits seulement par l’homme. La vocation elle-même des personnes et des peuples au développement ne se fonde pas sur une simple décision humaine, mais elle est inscrite dans un dessein qui nous précède et qui constitue pour chacun de nous un devoir à accueillir librement. Ce qui nous précède et qui nous constitue – l’Amour et la Vérité subsistants – nous indique ce qu’est le bien et en quoi consiste notre bonheur. Il nous montre donc la route qui conduit au véritable développement.