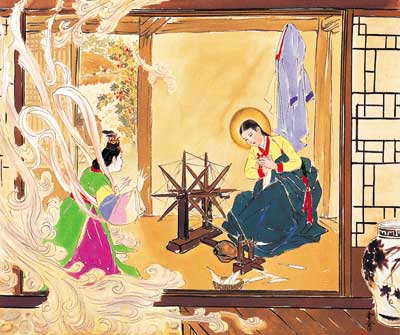Jean-Paul II, encyclique Centesimus annus :
36. Il convient maintenant d’attirer l’attention sur les problèmes spécifiques et sur les menaces qui surgissent à l’intérieur des économies les plus avancées et qui sont liés à leurs caractéristiques particulières. Dans les étapes antérieures du développement, l’homme a toujours vécu sous l’emprise de la nécessité. Ses besoins étaient réduits, définis en quelque sorte par les seules structures objectives de sa constitution physique, et l’activité économique était conçue pour les satisfaire. Il est clair qu’aujourd’hui, le problème n’est pas seulement de lui offrir une quantité suffisante de biens, mais de répondre à une demande de qualité : qualité des marchandises à produire et à consommer ; qualité des services dont on doit disposer ; qualité du milieu et de la vie en général.
La demande d’une existence plus satisfaisante qualitativement et plus riche est en soi légitime. Mais on ne peut que mettre l’accent sur les responsabilités nouvelles et sur les dangers liés à cette étape de l’histoire. Dans la manière dont surgissent les besoins nouveaux et dont ils sont définis, intervient toujours une conception plus ou moins juste de l’homme et de son véritable bien. Dans les choix de la production et de la consommation, se manifeste une culture déterminée qui présente une conception d’ensemble de la vie. C’est là qu’apparaît le phénomène de la consommation. Quand on définit de nouveaux besoins et de nouvelles méthodes pour les satisfaire, il est nécessaire qu’on s’inspire d’une image intégrale de l’homme qui respecte toutes les dimensions de son être et subordonne les dimensions physiques et instinctives aux dimensions intérieures et spirituelles. Au contraire, si l’on se réfère directement à ses instincts et si l’on fait abstraction d’une façon ou de l’autre de sa réalité personnelle, consciente et libre, cela peut entraîner des habitudes de consommation et des styles de vie objectivement illégitimes, et souvent préjudiciables à sa santé physique et spirituelle. Le système économique ne comporte pas dans son propre cadre des critères qui permettent de distinguer correctement les formes nouvelles et les plus élevées de satisfaction des besoins humains et les besoins nouveaux induits qui empêchent la personnalité de parvenir à sa maturité. La nécessité et l’urgence apparaissent donc d’un vaste travail éducatif et culturel qui comprenne l’éducation des consommateurs à un usage responsable de leur pouvoir de choisir, la formation d’un sens aigu des responsabilités chez les producteurs, et surtout chez les professionnels des moyens de communication sociale, sans compter l’intervention nécessaire des pouvoirs publics.
La drogue constitue un cas évident de consommation artificielle, préjudiciable à la santé et à la dignité de l’homme, et, certes, difficile à contrôler. Sa diffusion est le signe d’un grave dysfonctionnement du système social qui suppose une « lecture » matérialiste et, en un sens, destructrice des besoins humains. Ainsi, les capacités d’innovation de l’économie libérale finissent par être mises en oeuvre de manière unilatérale et inappropriée. La drogue, et de même la pornographie et d’autres formes de consommation, exploitant la fragilité des faibles, cherchent à remplir le vide spirituel qui s’est produit.
Il n’est pas mauvais de vouloir vivre mieux, mais ce qui est mauvais, c’est le style de vie qui prétend être meilleur quand il est orienté vers l’avoir et non vers l’être, et quand on veut avoir plus, non pour être plus mais pour consommer l’existence avec une jouissance qui est à elle-même sa fin (75). Il est donc nécessaire de s’employer à modeler un style de vie dans lequel les éléments qui déterminent les choix de consommation, d’épargne et d’investissement soient la recherche du vrai, du beau et du bon, ainsi que la communion avec les autres hommes pour une croissance commune. A ce propos, je ne puis m’en tenir à un rappel du devoir de la charité, c’est-à-dire du devoir de donner de son « superflu » et aussi parfois de son « nécessaire » pour subvenir à la vie du pauvre. Je pense au fait que même le choix d’investir en un lieu plutôt que dans un autre, dans un secteur de production plutôt qu’en un autre, est toujours un choix moral et culturel. Une fois réunies certaines conditions nécessaires dans les domaines de l’économie et de la stabilité politique, la décision d’investir, c’est-à-dire d’offrir à un peuple l’occasion de mettre en valeur son travail, est conditionnée également par une attitude de sympathie et par la confiance en la Providence qui révèlent la qualité humaine de celui qui prend la décision.
37. A côté du problème de la consommation, la question de l’écologie, qui lui est étroitement connexe, inspire autant d’inquiétude. L’homme, saisi par le désir d’avoir et de jouir plus que par celui d’être et de croître, consomme d’une manière excessive et désordonnée les ressources de la terre et sa vie même. A l’origine de la destruction insensée du milieu naturel, il y a une erreur anthropologique, malheureusement répandue à notre époque. L’homme, qui découvre sa capacité de transformer et en un sens de créer le monde par son travail, oublie que cela s’accomplit toujours à partir du premier don originel des choses fait par Dieu. Il croit pouvoir disposer arbitrairement de la terre, en la soumettant sans mesure à sa volonté, comme si elle n’avait pas une forme et une destination antérieures que Dieu lui a données, que l’homme peut développer mais qu’il ne doit pas trahir. Au lieu de remplir son rôle de collaborateur de Dieu dans l’œuvre de la création, l’homme se substitue à Dieu et, ainsi, finit par provoquer la révolte de la nature, plus tyrannisée que gouvernée par lui (76).
En cela, on remarque avant tout la pauvreté ou la mesquinerie du regard de l’homme, plus animé par le désir de posséder les choses que de les considérer par rapport à la vérité, et qui ne prend pas l’attitude désintéressée, faite de gratuité et de sens esthétique, suscitée par l’émerveillement pour l’être et pour la splendeur qui permet de percevoir dans les choses visibles le message de Dieu invisible qui les a créées. Dans ce domaine, l’humanité d’aujourd’hui doit avoir conscience de ses devoirs et de ses responsabilités envers les générations à venir.
38. En dehors de la destruction irrationnelle du milieu naturel, il faut rappeler ici la destruction encore plus grave du milieu humain, à laquelle on est cependant loin d’accorder l’attention voulue. Alors que l’on se préoccupe à juste titre, même si on est bien loin de ce qui serait nécessaire, de sauvegarder les habitats naturels des différentes espèces animales menacées d’extinction, parce qu’on se rend compte que chacune d’elles apporte sa contribution particulière à l’équilibre général de la terre, on s’engage trop peu dans la sauvegarde des conditions morales d’une « écologie humaine » authentique. Non seulement la terre a été donnée par Dieu à l’homme qui doit en faire usage dans le respect de l’intention primitive, bonne, dans laquelle elle a été donnée, mais l’homme, lui aussi, est donné par Dieu à lui-même et il doit donc respecter la structure naturelle et morale dont il a été doté. Dans ce contexte, il faut mentionner les problèmes graves posés par l’urbanisation moderne, la nécessité d’un urbanisme soucieux de la vie des personnes, de même que l’attention qu’il convient de porter à une « écologie sociale » du travail.
L’homme reçoit de Dieu sa dignité essentielle et, avec elle, la capacité de transcender toute organisation de la société dans le sens de la vérité et du bien. Toutefois, il est aussi conditionné par la structure sociale dans laquelle il vit, par l’éducation reçue et par son milieu. Ces éléments peuvent faciliter ou entraver sa vie selon la vérité. Les décisions grâce auxquelles se constitue un milieu humain peuvent créer des structures de péché spécifiques qui entravent le plein épanouissement de ceux qu’elles oppriment de différentes manières. Démanteler de telles structures et les remplacer par des formes plus authentiques de convivialité constitue une tâche qui requiert courage et patience (77).
39. La première structure fondamentale pour une « écologie humaine » est la famille, au sein de laquelle l’homme reçoit des premières notions déterminantes concernant la vérité et le bien, dans laquelle il apprend ce que signifie aimer et être aimé et, par conséquent, ce que veut dire concrètement être une personne. On pense ici à la famille fondée sur le mariage, où le don de soi réciproque de l’homme et de la femme crée un milieu de vie dans lequel l’enfant peut naître et épanouir ses capacités, devenir conscient de sa dignité et se préparer à affronter son destin unique et irremplaçable. Il arrive souvent, au contraire, que l’homme se décourage de réaliser les conditions authentiques de la reproduction humaine, et il est amené à se considérer lui-même et à considérer sa propre vie comme un ensemble de sensations à expérimenter et non comme une oeuvre à accomplir. Il en résulte un manque de liberté qui fait renoncer au devoir de se lier dans la stabilité avec une autre personne et d’engendrer des enfants, ou bien qui amène à considérer ceux-ci comme une de ces nombreuses « choses » que l’on peut avoir ou ne pas avoir, au gré de ses goûts, et qui entrent en concurrence avec d’autres possibilités.
Il faut en revenir à considérer la famille comme le sanctuaire de la vie. En effet, elle est sacrée, elle est le lieu où la vie, don de Dieu, peut être convenablement accueillie et protégée contre les nombreuses attaques auxquelles elle est exposée, le lieu où elle peut se développer suivant les exigences d’une croissance humaine authentique. Contre ce qu’on appelle la culture de la mort, la famille constitue le lieu de la culture de la vie.
Dans ce domaine, le génie de l’homme semble s’employer plus à limiter, à supprimer ou à annuler les sources de la vie, en recourant même à l’avortement, malheureusement très diffusé dans le monde, qu’à défendre et à élargir les possibilités de la vie elle-même. Dans l’encyclique Sollicitudo rei socialis, ont été dénoncées les campagnes systématiques contre la natalité qui, fondées sur une conception faussée du problème démographique dans un climat de « manque absolu de respect pour la liberté de décision des personnes intéressées », les soumettent fréquemment « à d’intolérables pressions […] pour les plier à cette forme nouvelle d’oppression » (78). Il s’agit de politiques qui étendent leur champ d’action avec des techniques nouvelles jusqu’à parvenir, comme dans une « guerre chimique », à empoisonner la vie de millions d’êtres humains sans défense.
Ces critiques s’adressent moins à un système économique qu’à un système éthique et culturel. En effet, l’économie n’est qu’un aspect et une dimension dans la complexité de l’activité humaine. Si elle devient un absolu, si la production et la consommation des marchandises finissent par occuper le centre de la vie sociale et deviennent la seule valeur de la société, soumise à aucune autre, il faut en chercher la cause non seulement et non tant dans le système économique lui-même, mais dans le fait que le système socio-culturel, ignorant la dimension éthique et religieuse, s’est affaibli et se réduit alors à la production des biens et des services (79).
On peut résumer tout cela en réaffirmant, une fois encore, que la liberté économique n’est qu’un élément de la liberté humaine. Quand elle se rend autonome, quand l’homme est considéré plus comme un producteur ou un consommateur de biens que comme un sujet qui produit et consomme pour vivre, alors elle perd sa juste relation avec la personne humaine et finit par l’aliéner et par l’opprimer (80).
40. L’Etat a le devoir d’assurer la défense et la protection des biens collectifs que sont le milieu naturel et le milieu humain dont la sauvegarde ne peut être obtenue par les seuls mécanismes du marché. Comme, aux temps de l’ancien capitalisme, l’Etat avait le devoir de défendre les droits fondamentaux du travail, de même, avec le nouveau capitalisme, il doit, ainsi que la société, défendre les biens collectifs qui, entre autres, constituent le cadre à l’intérieur duquel il est possible à chacun d’atteindre légitimement ses fins personnelles.
On retrouve ici une nouvelle limite du marché : il y a des besoins collectifs et qualitatifs qui ne peuvent être satisfaits par ses mécanismes ; il y a des nécessités humaines importantes qui échappent à sa logique ; il y a des biens qui, en raison de leur nature, ne peuvent ni ne doivent être vendus ou achetés. Certes, les mécanismes du marché présentent des avantages solides : entre autres, ils aident à mieux utiliser les ressources ; ils favorisent les échanges de produits ; et, surtout, ils placent au centre la volonté et les préférences de la personne, qui, dans un contrat, rencontrent celles d’une autre personne. Toutefois, ils comportent le risque d’une « idolâtrie » du marché qui ignore l’existence des biens qui, par leur nature, ne sont et ne peuvent être de simples marchandises.