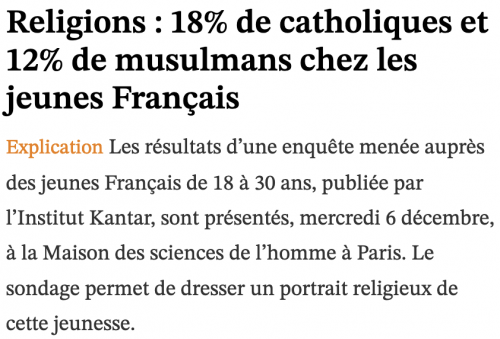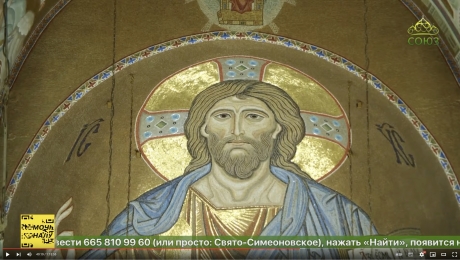L’excellent site New Liturgical Movement a publié une traduction anglaise d’un texte d’un théologien orthodoxe russe, Alexander Adomenas, transmis par un ami de ce théologien qui est… Mgr Athanasius Schneider. En voici une traduction française. Mais c’est le texte anglais qui fait foi. Ce qui est ici important est ce que dit Alexander Adomenas de la réforme liturgique « latine » car, bien que portant un regard extérieur, il a tout compris, bien mieux que la plupart des théologiens « catholiques » de notre temps. Mais ce n’est pas un regard extérieur, c’est celui de la tradition, qui, profondément, reste une.
« Où chercher un véritable œcuménisme ?
Une réflexion sur les réformes liturgiques de l’Église catholique romaine dans une perspective œcuménique
Par Alexander Adomenas, maître en théologie
« Afin que tous soient un » (Jean 17, 21) – ces paroles de notre divin Maître résonnent avec douleur dans le cœur des chrétiens depuis de nombreux siècles. Malheureusement, nous n’avons pas respecté le commandement de notre Seigneur et nous nous sommes divisés. Le vingtième siècle a montré qu’il était temps, selon la parole de l’Ecclésiaste, de « ramasser les pierres » (3, 5), les pierres que nous, chrétiens, avons dispersées pendant vingt siècles. Le saint pape Grégoire le Grand (qui porte en Orient le nom de Dialogos) explique ces paroles comme suit : « Plus la fin du monde approche, plus il est nécessaire de rassembler des pierres vivantes pour une construction céleste, jusqu’à ce que l’édifice de notre Jérusalem atteigne sa mesure »[1]. Pour saint Grégoire, « rassembler des pierres » signifie rassembler les gens dans l’unique Église du Christ.
Cependant, nous savons bien que l’on peut « ramasser des pierres » de différentes manières, et qu’en voulant tout ramasser, on peut être accablé par leur poids et perdre même ce que l’on a ramassé. Cet article, sous forme de réflexion, est une modeste tentative d’un théologien orthodoxe de réfléchir à la voie que l’on peut choisir pour ce « ramassage de pierres ».
L’histoire des relations entre le catholicisme et l’orthodoxie est malheureusement bien triste. Accusations mutuelles, divergences parfois sur des questions insignifiantes, tout cela s’est produit. Je ne ferai pas de bilan théologique de ces désaccords et de ces querelles séculaires. Je dirai simplement que ce qui nous unit est bien plus important que ce qui nous divise. Et c’est précisément le moment où, face à la sécularisation croissante de l’humanité et aux défis que le monde moderne pose aux croyants, nous devons trouver un terrain d’entente pour que tous sachent que nous sommes des disciples du Christ-Amour incarné (cf. Jn 13, 35).
Au cours des cent dernières années, cette tentative de réconciliation entre l’orthodoxie et le catholicisme a reçu le nom de « mouvement œcuménique ». De nombreux modèles de dialogue au sein de ce mouvement ont été proposés, mais tous, malheureusement, ont atteint ou atteignent une impasse. Le problème, à mon avis, réside dans la mauvaise approche du problème en tant que tel. Ou plutôt, il n’y a pas de noyau autour duquel un dialogue peut être construit. Et il me semble que la solution idéale est de faire appel à un héritage commun : l’histoire vivante de l’Église dans l’Esprit Saint.
Le catholicisme et l’orthodoxie ont une racine commune : l’enseignement du Christ et des apôtres. Nous avons préservé l’image de l’Église établie par les apôtres et leurs successeurs : la succession apostolique dans le sacerdoce, la structure hiérarchique de l’Église, les saints sacrements, notre mode de vie ecclésiale. C’est exactement ce qui peut et doit nous unir ; ce n’est pas pour rien que nous reconnaissons presque tous les sacrements les uns des autres [2], y compris le sacrement du sacerdoce, qui parle aussi de la reconnaissance de la hiérarchie des uns et des autres.
Ainsi, la manière de « rassembler les pierres » peut et doit être notre lien avec ce que l’on appelle, dans l’Église orthodoxe comme dans l’Église catholique, la Tradition sacrée. L’héritage séculaire, l’héritage de l’Église, est vraiment ce qui nous unit et rend possible la réalisation de l’unité. Le Concile Vatican II l’a souligné : « La fonction enseignante n’est pas au-dessus de la Parole de Dieu, mais elle la sert, n’enseignant que ce qui a été transmis… Il est donc clair que la Sainte Tradition, la Sainte Écriture et l’autorité enseignante de l’Église, selon le très sage dessein de Dieu, sont tellement liées et unies que l’une ne va pas sans l’autre. » [3]
Cependant, mes nombreuses années de connaissance du catholicisme, de la situation actuelle de l’Église catholique, suggèrent que, malheureusement, le catholicisme d’aujourd’hui ne veut pas choisir la voie de la Tradition sacrée. Je ne veux pas dire que l’Église catholique le fait délibérément. Pas du tout. Mais par nombre de ses actions, elle repousse vraiment une possible unité avec les Églises orthodoxes. Pour une raison quelconque, le dialogue avec les diverses dénominations protestantes est plus important pour l’Église catholique, bien qu’elles s’opposent délibérément aux Églises historiques qui ont préservé la Tradition sacrée. Je ne veux en aucun cas offenser les protestants, mais les enseignements orthodoxes et catholiques disent que l’orthodoxie et le catholicisme sont beaucoup plus proches l’un de l’autre que l’un ou l’autre ne l’est du protestantisme. De plus, nous devons affirmer que la plupart des dénominations protestantes s’opposent consciemment aux Églises historiques ayant une succession apostolique ; elles disent que leur théologie est différente de la nôtre en tout, et notre adhésion à la Sainte Tradition devient souvent l’objet au moins d’un sourire condescendant, sinon de dérision et de mépris de la part des protestants. [4]
Partant de là, la tentative d’unir les orthodoxes et les catholiques aurait semblé être la voie idéale à suivre. Pourtant, le catholicisme, me semble-t-il, a pris le chemin inverse. Et cela se voit en tout. Cependant, pour expliquer ma pensée, je voudrais considérer plusieurs aspects. Et parmi eux, le principal est l’aspect liturgique.
La Liturgie sacrée, le culte divin, est le fondement de l’Église. Sans le culte, sans l’Eucharistie, l’Église ne peut exister. En effet, tout au long de l’histoire, l’Église s’est rassemblée autour du sacrifice eucharistique. Bien sûr, toutes les Églises historiques ayant une succession apostolique ont créé leurs propres rites liturgiques autour de l’Eucharistie, sur la base desquels l’Église a travaillé à travers ses membres pendant de nombreux siècles, en acceptant organiquement les aspects nouveaux et en rejetant ce qui est étranger. La liturgie est la physionomie, la manifestation de l’Église, son incarnation visible dans le monde.
Tout changement forcé et inorganique peut entraîner de très grands bouleversements. L’Église orthodoxe russe en a fait la tragique expérience. Au XVIIe siècle, le patriarche orthodoxe russe Nikon a décidé de rompre la tradition liturgique russe qui s’était développée pendant 500 ans, en imposant de force une tradition grecque similaire, mais formée dans un contexte historique différent. Les autorités de l’État et de l’Église de l’époque ont mis en œuvre ces réformes par la force, en arrêtant et en tuant tous ceux qui n’étaient pas d’accord. Cela a conduit un tiers de l’Église russe à entrer en schisme, un schisme qui n’a toujours pas été guéri à ce jour. De plus, comme il y avait peu d’évêques dans l’Église russe à ce moment-là – un seul n’était pas d’accord avec la réforme et s’est finalement séparé – les Vieux Croyants ont été marginalisés et certains d’entre eux ont perdu la prêtrise et les sacrements. [5]
L’expérience amère de l’Église orthodoxe russe a été soit inconnue, soit ignorée par l’Église catholique au XXe siècle. Pour une raison ou une autre, les autorités de l’Église catholique de notre époque ont décidé de modifier la liturgie. Il n’y a rien de mal à modifier un rite. Ceux qui sont plus ou moins familiers avec les principes de la liturgie comparée d’Anton Baumstark [6] savent que les changements dans n’importe quel rite sont la norme de la vie de l’Église. Mais les changements rituels ne fonctionnent bien que lorsque, premièrement, ils sont nécessaires, c’est-à-dire lorsque ces changements sont appelés à éclairer plus complètement l’un ou l’autre aspect de la vie de l’Église, et deuxièmement, et c’est le plus important, lorsqu’ils se produisent dans le cadre de l’enseignement de l’Église et du rite liturgique valide existant.
L’objectif des réformes liturgiques des années 1960 était noble : raviver la participation du peuple de Dieu à la Sainte Eucharistie. L’objectif est bon et, en fait, nécessaire. Pourtant, au lieu d’inciter le peuple de Dieu à une participation plus vivante et plus active à l’Eucharistie – par des chants communs, des réponses aux exclamations du prêtre, voire une modification légère et organique de l’ordre de la Sainte Messe – l’autorité ecclésiastique de l’Église catholique a décidé de changer radicalement à la fois l’ordo de la Messe et le rite latin dans son ensemble. Et ce, en dépit du fait que les décisions du Concile Vatican II indiquaient elles-mêmes que les changements devaient être très équilibrés et délibérés : « Afin de conserver la saine tradition, tout en laissant la voie ouverte à un progrès légitime, on procédera toujours à un examen attentif de chaque partie de la liturgie que l’on veut réviser. Cette recherche doit être théologique, historique et pastorale… Il ne doit pas y avoir d’innovations à moins que le bien de l’Église ne l’exige réellement et certainement ; et il faut veiller à ce que toutes les nouvelles formes adoptées se développent d’une certaine manière organiquement à partir des formes déjà existantes ». [7]
Cette norme de la Constitution conciliaire Sacrosanctum Concilium a-t-elle été appliquée correctement ? Les faits eux-mêmes disent le contraire. Prenons, par exemple, l’Offertoire (une partie de l’Ordo de la Messe durant laquelle le pain et le vin sont apportés à l’autel avec des prières en vue de la consécration). Il a été complètement réformé. Je n’arrive toujours pas à comprendre pourquoi il fallait le faire. En regardant le nouveau rite de l’Offertoire, on ne voit pas du tout quel type de « recherche théologique, historique et pastorale » a été effectué sur les instructions directes du Concile pour introduire ce changement. Pourquoi ne pas se tourner vers les anciens missels romains, où l’on trouve diverses formes anciennes pratiquées dans le rite latin ? Pourquoi composer de nouvelles prières, manifestement empruntées aux Berakhot juives ? Pour montrer le lien entre l’Ancien et le Nouveau Testament ? Je suis sûr que tous les prêtres qui célèbrent la liturgie connaissent ce lien. Pour faire revivre les éléments du culte juif ? À l’exception des éléments apportés par les premières générations après les apôtres, l’Église n’a jamais eu dans son histoire une telle tendance à la judaïsation [8]. Reconnaître l’importance du judaïsme et commencer à honorer les juifs comme leurs « frères aînés » ? Je crains que 99,9% des juifs n’aient aucune idée de l’existence de cet élément dans la messe catholique. En d’autres termes, nous ne voyons tout simplement pas de fondement pastoral, théologique ou historique à ce changement dans le rite de l’Offertoire ; il n’a pas non plus émergé organiquement de quelque chose qui existait déjà ; il n’était pas non plus véritablement et certainement nécessaire.
De plus, la prière centrale de la Messe est le Canon eucharistique. Dans le rite byzantin, deux canons eucharistiques sont utilisés comme norme – celui de saint Basile le Grand et celui de saint Jean Chrysostome. Ces canons eucharistiques sont utilisés par l’Église depuis plus de 1.500 ans. L’Occident disposait du Canon romain, d’une ancienneté et d’une centralité similaires. De nos jours, l’Église catholique a emprunté une voie totalement différente, celle de la composition de nouveaux textes pour le Canon eucharistique. En même temps, les partisans du Nouveau Rite soulignent que les nouvelles prières eucharistiques ont été écrites sur la base d’anciens textes orientaux [9]. Mais toute personne plus ou moins versée dans la science liturgique verra que cette similitude est en fait assez éloignée et que les nouvelles prières eucharistiques du rite romain sont de nouveaux textes qui ne sont sanctifiés ni par l’usage qu’en a fait la tradition, ni par l’enseignement de l’Église, et qui semblent même parfois aller à l’encontre de celui-ci [10]. Pourquoi a-t-on fait cela ? Je reste silencieux sur le lectionnaire et le calendrier liturgique entièrement redessinés et sur le système modifié de l’Office divin et des propres – des textes en quelque sorte écrits par des saints et sanctifiés par le temps, mais qui ont cessé de résonner au cours de la liturgie catholique. Ils n’ont tout simplement pas trouvé leur place dans le nouveau rite.
Pourquoi cela a-t-il été fait ? Pourquoi la réforme a-t-elle été si radicale ? Nous trouverons la réponse en nous penchant sur les auteurs de la réforme et sur ce qui les a inspirés. Pour réaliser la réforme des livres liturgiques, la Commission s’est ouvertement appuyée sur l’expérience du culte protestant, s’inspirant de la théologie protestante de l’Eucharistie (Cène, repas, communauté…) pour introduire des changements. L’Église catholique a ainsi délibérément rejeté sa propre expérience, son héritage, rejeté l’expérience des Églises orientales qui ont préservé une compréhension vivante de l’Eucharistie comme liturgie du Corps et du Sang du Sauveur, pour s’engager sur la voie de la théologie protestante, dont les adeptes non seulement ne croient pas à la présence eucharistique réelle et véritable du Corps et du Sang du Christ, mais ont même créé leurs propres rites cultuels en opposition à la messe catholique.
Souvent, ce changement est expliqué par l’idée de l’œcuménisme, en disant : « Voici que notre liturgie s’est rapprochée de celle des protestants et que nous sommes désormais plus proches d’eux. » En est-il vraiment ainsi ? Les protestants croient-ils que les catholiques sont devenus plus proches d’eux en raison de leur approche extérieure de la liturgie ? C’est loin d’être le cas. Dieu merci, malgré la forme extérieure déficiente, l’essence de l’Eucharistie en tant que présence réelle du corps et du sang de Jésus-Christ dans le sacrement est restée ferme dans la doctrine officielle de l’Église catholique. Pour un protestant, la célébration eucharistique n’est qu’un souvenir de la dernière Cène, contrairement aux Églises orientales, où l’on a toujours cru que nous participions réellement au corps et au sang du Christ. Chaque prêtre et fidèle orthodoxe dit avant la Sainte Communion : « Je crois que ce qui est dans le calice est ton vrai sang ». [11] Les protestants comprennent cette différence, de sorte que la réforme liturgique de l’Église catholique n’a pas entraîné de véritable rapprochement. C’est-à-dire que les catholiques n’ont rien gagné, mais ils ont beaucoup perdu.
Non seulement les autorités de l’Église catholique ont créé un nouveau rite de la messe, mais elles ont immédiatement et incroyablement interdit l’utilisation de l’ancien rite consacré. En effet, les cinquante dernières années ont été une lutte pour les personnes qui voulaient utiliser l’ancien rite, dont les origines remontent à l’époque de saint Grégoire le Grand et qui a été vécu et expérimenté par presque tous les saints d’Occident depuis lors. Ce fut une lutte pour obtenir le droit d’être fidèle à ce rite des saints. Cinquante ans d’humiliation, de dérision et de tentatives pour survivre. Le pontificat actuel a déclaré en substance que l’ancien rite n’avait pas le droit d’exister et que le fait qu’il soit désormais autorisé à être utilisé n’était qu’une mesure temporaire. En quoi les autorités de l’Église catholique d’aujourd’hui sont-elles différentes de celles qui ont imposé la marginalisation des vieux croyants en Russie ?
Les autorités actuelles de l’Église catholique disent que les catholiques n’ont qu’une seule messe, qu’un seul rite. Elles essaient même de pervertir et de « diversifier » ce rite unique pour plaire à l’époque actuelle. On constate souvent que de nombreux prêtres de l’Église catholique célèbrent le nouveau rite de la Messe ad libitum, insérant des changements et des ajouts de leur propre initiative, en faisant appel à de prétendus objectifs pastoraux ; ils peuvent changer la Messe d’une manière ou d’une autre, sans parler de la liturgie dans le Chemin néocatéchuménal et le Mouvement charismatique, ou des inculturations proposées. [12]
En définitive, qu’avons-nous ? Liturgiquement, le catholicisme s’est égaré. Il est allé à la rencontre des protestants, leur tendant les bras, et les protestants se sont détournés et sont allés plus loin, vers le sacerdoce féminin et, en général, vers la dilution de l’idée même de christianisme. Le catholicisme s’est retrouvé avec des bras vides et tendus. Il ne s’est pas rapproché des protestants (même si, dès le départ, il aurait dû être clair que cette approche était irréaliste). Simultanément, le catholicisme s’est éloigné de l’Orient, qui s’appuie sur la Tradition ; en fait, il est allé si loin que la ligne rouge entre le protestantisme et le catholicisme est aujourd’hui diluée dans l’esprit des orthodoxes, qu’il s’agisse de théologiens ou de simples croyants.
Bien entendu, je n’appelle à aucune action spécifique, ce serait trop présomptueux. J’ai simplement voulu partager la douleur qu’éprouve un croyant orthodoxe dont la foi est fondée sur la Tradition sacrée lorsqu’il regarde l’Église catholique d’aujourd’hui. Cependant, je veux croire que le Christ, qui désire l’unité de ses disciples, ramènera dans la communion les Églises historiques d’Orient et d’Occident avec la succession apostolique, les unira avec l’amour qu’avaient les saints qui ont créé ce trésor de foi et de liturgie – la vie éternelle et impérissable de l’Église, fondée sur la Tradition sacrée dans l’Esprit Saint.
[1] Dial. 37.
[2] Dans l’orthodoxie, il existe deux approches divergentes de ce problème, mais la reconnaissance des sacrements de l’Église catholique est beaucoup plus enracinée dans la tradition, qui se reflète également dans les textes liturgiques.
[3] Dei Verbum, 10.
[4] Pour ne pas être démenti, il suffit de rappeler que les premiers protestants ont immédiatement commencé à appeler l’Église catholique « la Prostituée de Babylone », voir J. Pelikan/H. Lehmann, Luther’s Luther’s Church. Lehmann, Œuvres de Luther 39:102.
[5] On peut lire des informations détaillées à ce sujet : P. Meyendorff : Russia, Ritual and Reform : The Liturgical Reforms of Nikon in the 17th Century. St Vladimir’s Press (1991), et en russe : Каптерев Н.Ф.. : Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковныx обрядов, Москва, 1913.
[6] Baumstark А. Sur le développement historique de la liturgie (Vom geschichtlichen Werden der Liturgie, 1923) ; intr. et traduction de Fritz West ; préface de Robert F. Taft. Collegeville, Minn. : Liturgical Press 2011.
[7] Sacrosanctum Concilium, 23.
[8] Même dans ces deux premières générations chrétiennes, il y a très peu de parallèles avec le culte de la synagogue, si ce n’est que la Didaché en porte quelques traces.
[9] Bien que tout mélange de rituels soit très laid.
[10] Tout au long de l’histoire, le rite latin a mis l’accent sur le lien entre l’eucharistie et le sacrifice, ce qui constitue en fait la base de la compréhension de l’eucharistie en Occident.
[11] Le rite de la liturgie byzantine de saint Jean Chrysostome. Prière avant la Sainte Communion.
[12] Le mouvement charismatique, le parler en langues dans l’Église, est mort au IIe siècle, nous ne savons même pas de quel type de parler il s’agissait. Et que voyons-nous aujourd’hui ? Un groupe de personnes est convaincu de parler en langues, et les hiérarques catholiques n’ont pas peur de pécher contre le Saint-Esprit (voir Marc 3, 22-30) en soutenant une telle pratique. Je n’ai pas trouvé un seul ouvrage théologique sérieux qui, sur la base de l’histoire de l’Église, évoque un consensus des Pères en faveur du soutien à la possibilité du parler en langues dans l’Église. L’extrême prudence à l’égard de ces pratiques charismatiques est également confirmée par de nombreux saints de l’Église.